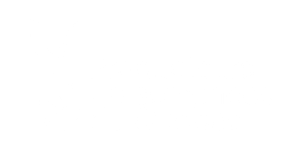Résumé vulgarisé
Ce projet visait à étendre les connaissances actuelles sur la mouche des semis en déterminant et en hiérarchisant les facteurs de risque les plus importants qui favorisent l’infestation des grandes cultures par ce ravageur. Il visait également à étudier l’attraction et la fécondité de la mouche des semis en réponse à différents amendements organiques identifiés comme les plus importants pour prédire les risques d’infestation. Les connaissances issues de ce projet permettent d’aider les conseillers agronomes et les producteurs agricoles à identifier les facteurs de risque qui favorisent la MS et d’évaluer le besoin (ou non) d’utiliser des traitements de semences tout en s’inscrivant dans le cadre d’une gestion intégrée de ce ravageur.
Crédit photo : CÉROM